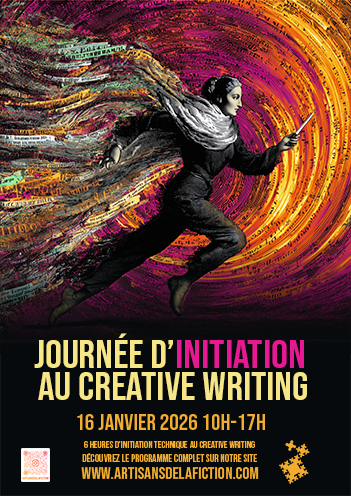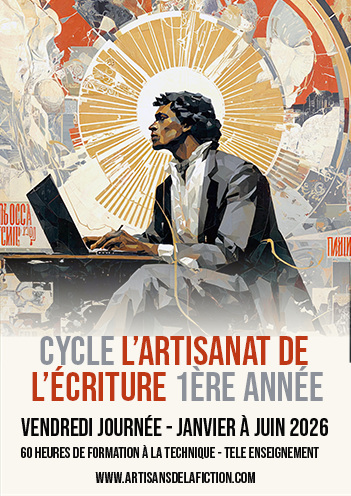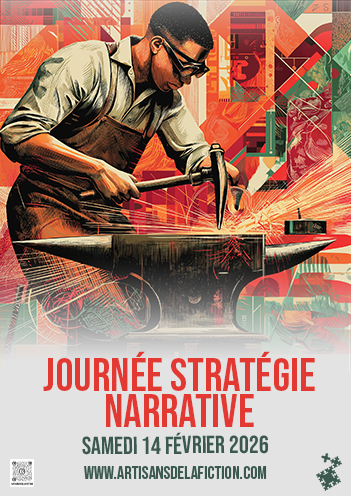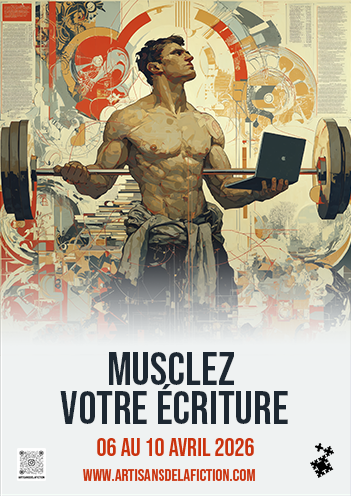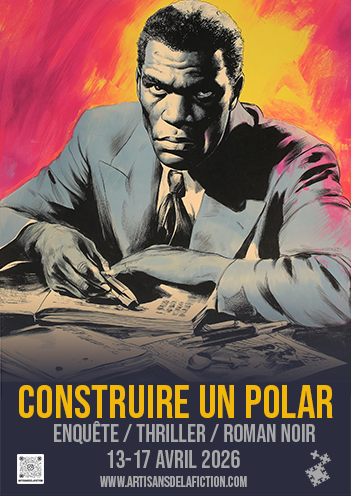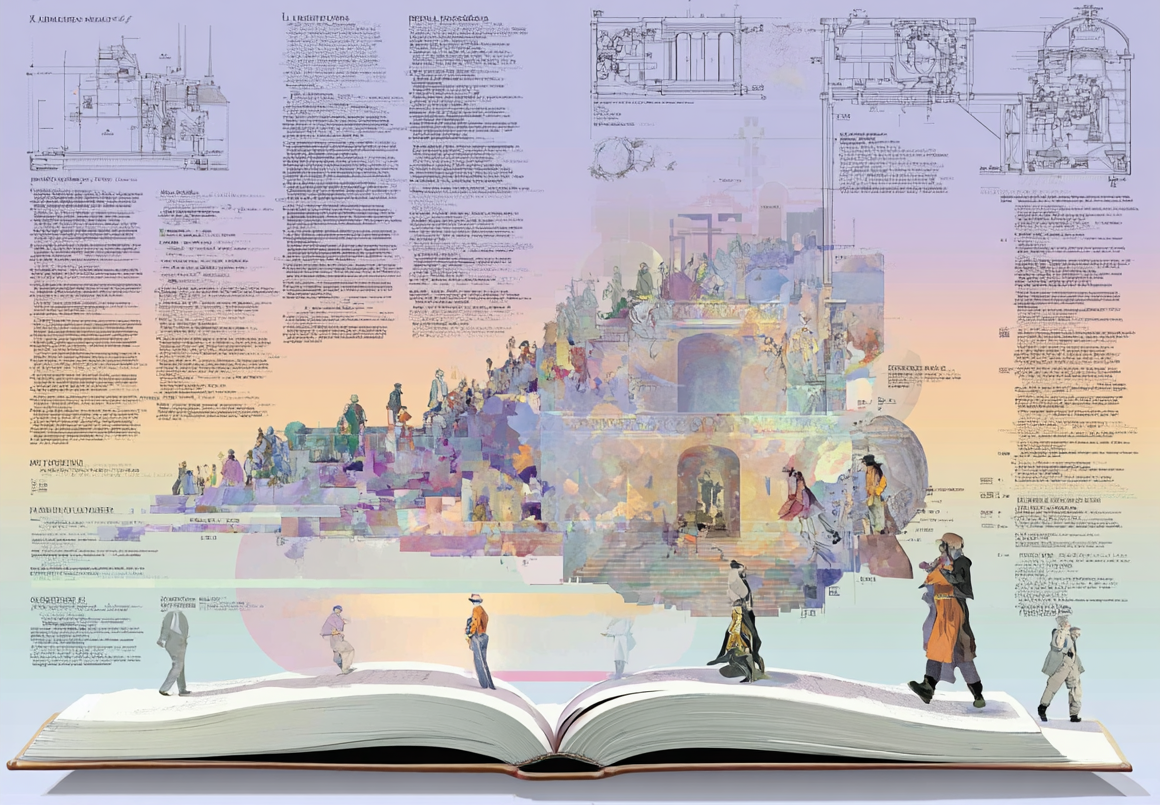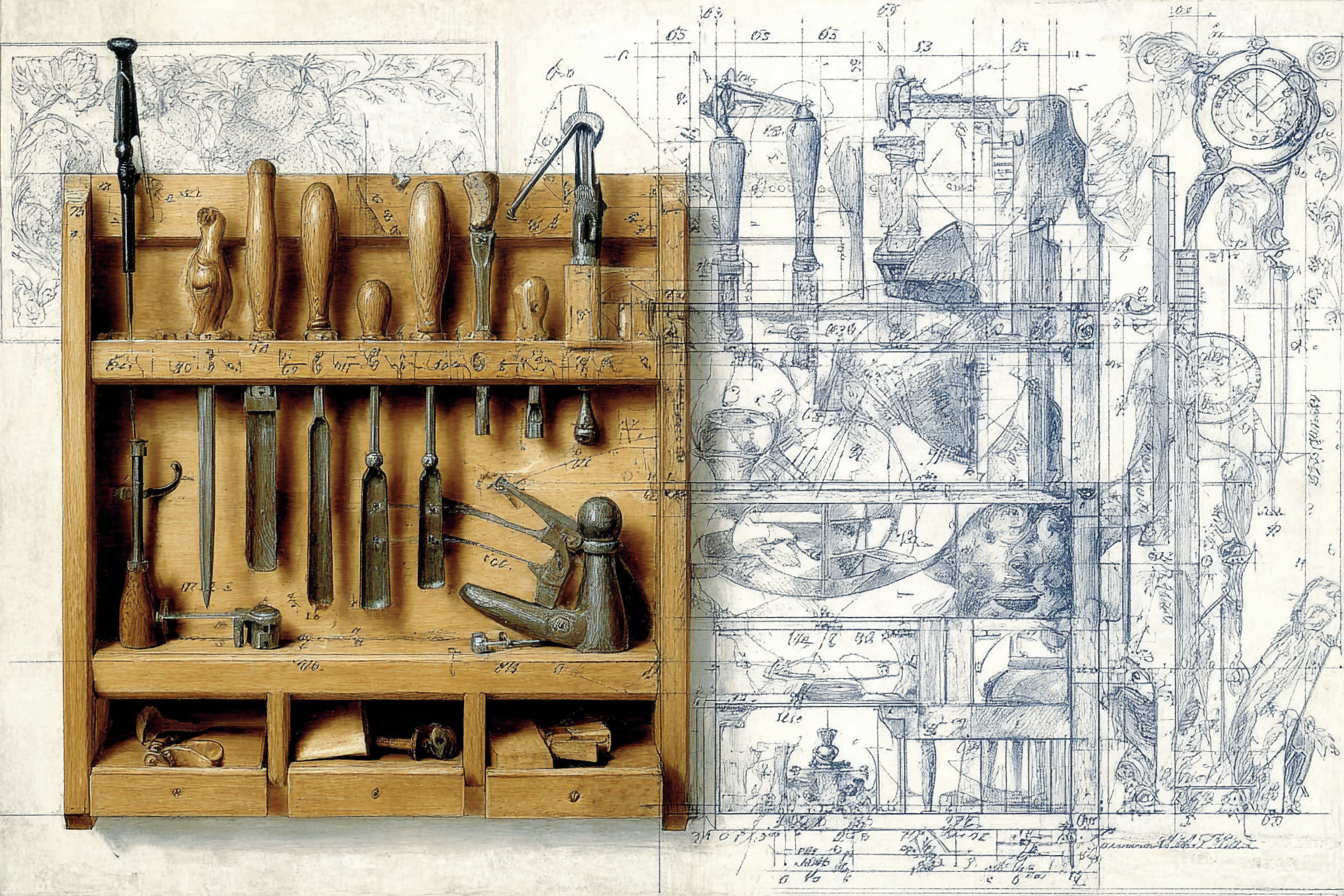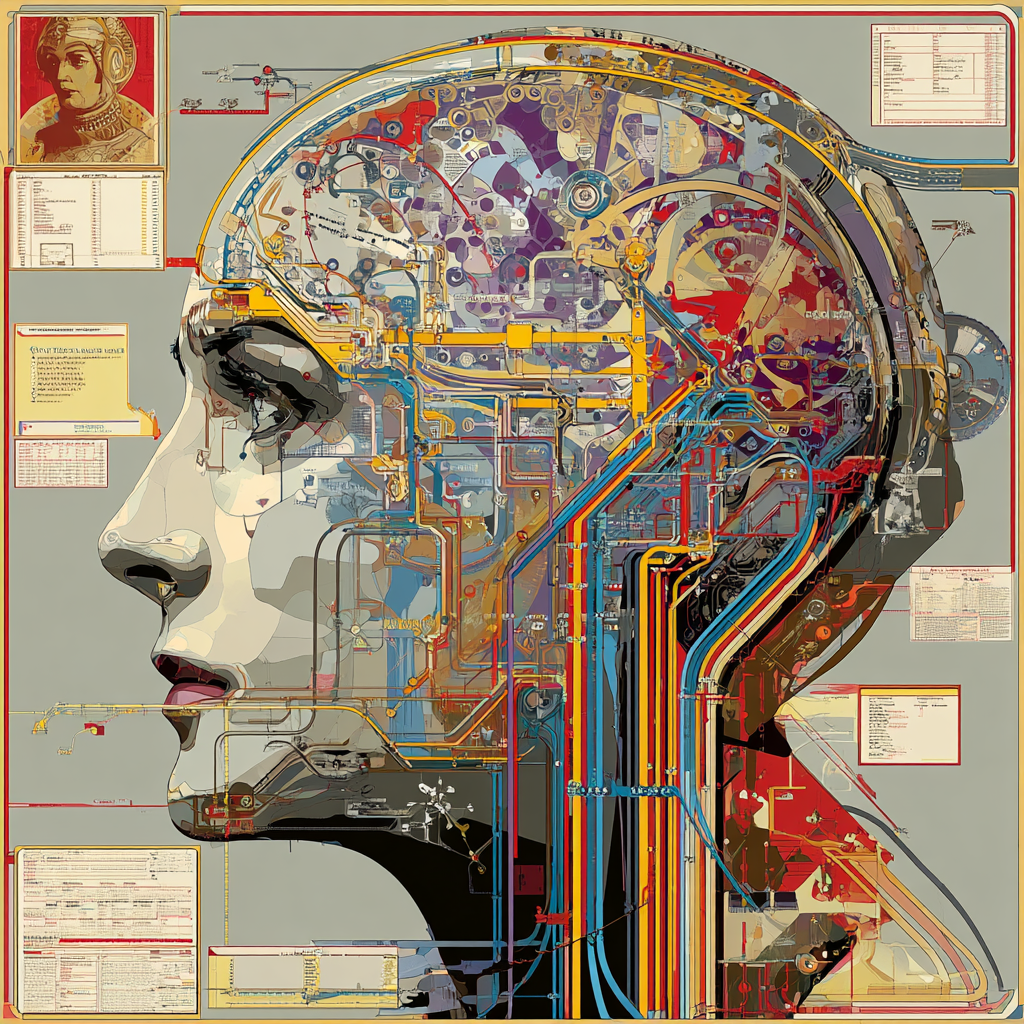On vous a vendu l’écriture comme un loisir fragile, une activité « sensible » réservée aux âmes littéraires. Christophe Molmy démolit ce cliché. Ancien chef de la BRI, il écrit ses romans comme on mène une opération : préparation implacable, chapitres courts, cliffhangers calculés, regard sans complaisance sur la nature humaine. Pas de poses esthétiques, pas de manichéisme confortable : seulement des zones grises, des subjectivités contradictoires et des histoires qu’on ne lâche pas. Si vous rêvez d’écrire en douceur, passez votre chemin. Si vous voulez écrire pour de bon, lisez-le.
« En réalité, il n’y a pas de manichéisme profond chez les gens. Il n’y a que des nuances. »
Christophe Molmy vient d’un monde où l’hésitation coûte cher. Ancien patron de la BRI de Paris, acteur de première ligne lors des attentats du 13 novembre 2015, il a appris à décider vite, à évaluer les zones grises, à agir dans l’urgence sans sacrifier la lucidité. Ses romans policiers portent la trace de cette école-là : pas de pose, peu de bavardage, un rapport au réel dur, précis, presque clinique.
Quand il passe à l’écriture, Molmy ne se transforme pas en poète vaporeux. Il reste ce qu’il est : un praticien du réel, obsédé par la nuance morale, par la vraisemblance, par le fait de tenir son lecteur comme on tient une opération, sans faille et sans relâche. Écrire, chez lui, n’est ni une rêverie ni un hobby du dimanche, mais une façon d’affronter la nature humaine et de la mettre en scène de la manière la plus efficace possible.
« Un chapitre doit être court, rythmé, avec une fin qui donne envie d’embrayer sur le prochain… L’idée, c’est d’avoir des ellipses de façon à ce que vous teniez le roman et que vous ne le lâchiez pas tant que vous n’avez pas terminé. »
Écrire implacablement, chez Molmy, ce n’est pas être brutal. C’est être cohérent, structuré, sans complaisance. Avec le lecteur. Avec ses personnages. Avec soi-même.

I. Du terrain au texte : un auteur sans alibi
Il faut partir de là : Molmy n’est pas un « littéraire » de formation. Il le dit lui-même, presque avec gourmandise.
« Je n’ai pas été formé du tout à l’écriture. Pas de bac littéraire, pas d’environnement littéraire. J’étais pas du tout destiné à ça. »
Le premier roman est empirique, nourri de la réalité policière immédiate, de ce qu’il voit, de ce qu’il vit. Mais très vite, Molmy refuse de s’enfermer dans l’auto-fiction professionnelle. Il s’éloigne du document brut, glisse du roman de PJ vers le thriller, se donne le droit de s’éloigner des dossiers, tout en restant accroché à un principe cardinal : tout doit rester vraisemblable.
« Il n’y a rien de surréaliste dans ce que j’écris. Tout peut arriver ou est arrivé. »
Le geste est important pour les auteurs : il montre qu’on peut partir d’un socle réaliste, puis se déplacer vers la fiction pure, sans perdre la crédibilité. L’implacable, ici, n’est pas la fidélité documentaire servile, mais la cohérence interne : les actes, les réactions, les systèmes moraux doivent tenir.
L’autre point fondamental, c’est sa vision des personnages. Molmy n’écrit ni des héros ni des monstres, mais des êtres humains qui oscillent.
« Je n’ai jamais rencontré de gens parfaitement absous de tout reproche, ni complètement noirs. En réalité, il n’y a que des nuances, et c’est ça qui est intéressant : les contrastes. »
À partir de là, l’écriture ne peut pas se permettre le confort : il faut aller chercher les recoins, les contradictions, les dissonances. Écrire implacablement, c’est refuser le manichéisme rassurant.
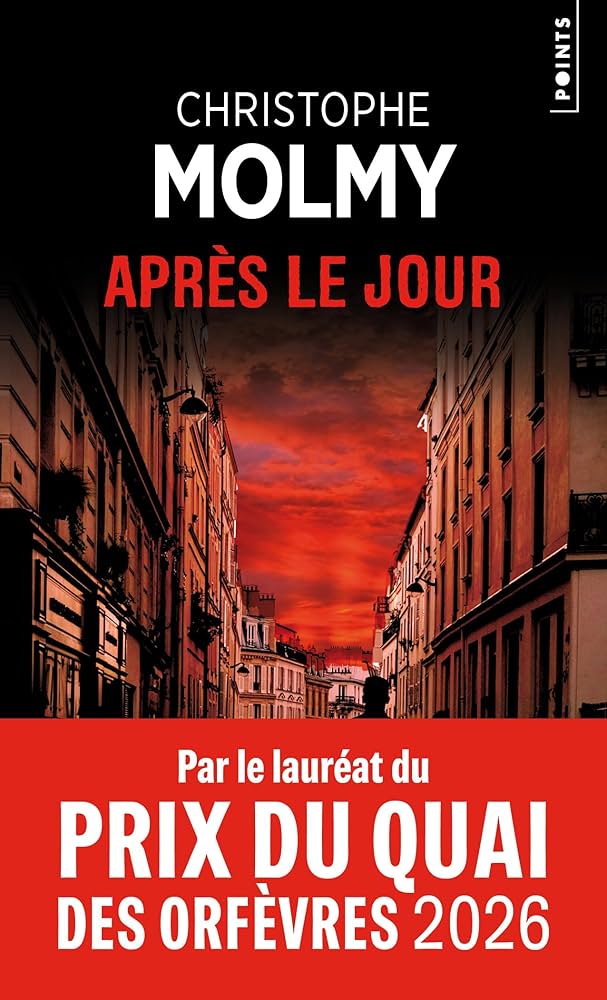
II. La Bible, ou l’implacable préparation
Molmy n’est pas un improvisateur génial qui « sent » son roman. Il travaille. Longtemps. Lentement.
« Je mets parfois deux ans, trois ans à écrire un livre. »
Pour tenir sur la durée, il se fabrique un outil : une Bible.
Dans cette Bible, il consigne l’histoire, les intentions, mais aussi la chair des personnages : taille, apparence, situations familiales, travail, éléments biographiques parfois jamais utilisés dans le roman. Ces détails ne sont pas là pour remplir des fiches, mais pour permettre à l’auteur d’« incarner » les personnages dans sa tête, de les voir se déplacer.
« Cette Bible permet d’abord d’incarner, de donner de la chair aux personnages, même avec des choses dont je ne vais pas me servir dans le roman. Mais ça me permet de l’imaginer, de l’incarner dans mon esprit. »
L’enseignement pour les auteurs est brutal mais utile : si vous écrivez sur plusieurs années, sans support solide, vos personnages se délitent. La Bible n’est pas un gadget ; c’est ce qui garantit l’implacable continuité du récit.
Et surtout, cette préparation structurelle lui permet d’aborder l’écriture comme un déroulé quasi cinématographique : il « fait le film des chapitres » avant même de rédiger, puis s’y tient. L’implacable, ici, c’est la fidélité au mouvement du récit décidé en amont.
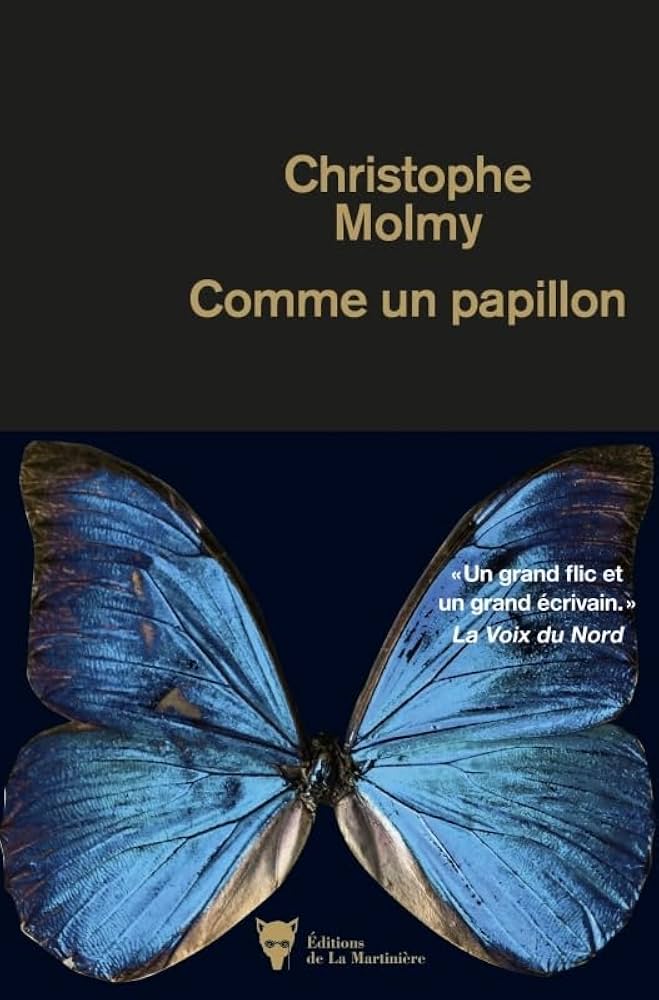
III. Chapitres courts, cliffhangers et point de vue : l’art de la prise d’otage narrative
Molmy n’a aucune envie d’écrire des pavés.
« Les romans en soi ne sont pas très longs, 200 ou 300 pages. Je ne suis pas très adepte des pavés, ça m’épuise un peu d’emblée. Je veux quelque chose d’assez digeste. »
Son choix formel est clair : chapitres courts, rythmés, centrés sur un seul point de vue, avec un cliffhanger en sortie. Pas de relâche. Pas de flottement.
« Un chapitre doit être court, sous un seul point de vue, avec une entrée et une sortie claires. Et surtout une fin de chapitre qui permet d’embrayer sur le prochain pour que le lecteur se dise : “J’en lis encore un, et j’arrêterai après”… et en définitive, il se laisse aller. »
Écrire implacablement, ce n’est pas seulement « avoir une bonne histoire ». C’est construire une mécanique de lecture qui rend la pause difficile. L’ellipse devient un outil central : on coupe, on saute, on relance. Le lecteur est maintenu dans un état de tension légère, mais continue.
Côté point de vue, Molmy utilise les perspectives multiples de manière stratégique : non pas pour faire joli, mais pour montrer la même scène sous deux angles subjectifs radicalement différents.
« Dans le dernier, vous avez une scène d’un homme qui vit une relation intime avec une femme, puis un autre chapitre avec la même relation, vécue de la part de cette femme. Lui passe un bon moment, elle a l’impression d’avoir été violée. »
L’implacable, là, c’est la subjectivité. Il ne s’agit plus de dire « voilà la vérité », mais « voilà deux vérités incompatibles ». Le lecteur est forcé de penser. Et de choisir.
 IV. Réécrire sans s’épuiser : couper, encore couper
IV. Réécrire sans s’épuiser : couper, encore couper
Molmy n’idéalise pas la réécriture. Il la considère comme un passage obligé, mais refuse qu’elle devienne un gouffre.
« Je réécris, mais je sais que je vais garder en moyenne deux tiers de l’écriture. Dès qu’une phrase ne me plaît pas ou que quelque chose ne marche pas, je coupe plutôt que d’essayer de le reprendre. »
C’est une leçon importante pour les auteurs qui s’autodétruisent à force de reprendre la même page : l’implacable, ici, c’est la lucidité. On ne sauve pas tout. On coupe. On assume la perte. On avance.
Et surtout, Molmy insiste sur la réécriture à quatre mains avec l’éditrice :
« Le travail de l’éditrice est extrêmement important. Il y a un huis clos entre l’éditeur et l’auteur. C’est elle qui aide à retailler, à prendre confiance sur certains aspects, à en retirer d’autres. »
Écrire implacablement, ce n’est pas écrire seul contre tous. C’est accepter le regard extérieur, non pas comme une menace, mais comme un outil de resserrage.
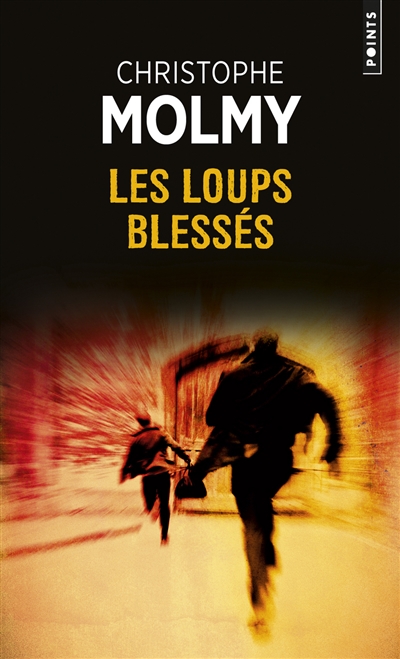
V. Thèmes, personnages et vraisemblance morale
Molmy le dit très clairement : il ne part pas du personnage, mais du sujet.
« Les personnages servent l’histoire. Je ne crée pas un personnage autour duquel je crée une histoire. J’ai l’idée d’un sujet qui m’intéresse. Le dernier, par exemple, c’est le viol et le consentement. Et ensuite, pour servir cette histoire, je crée des personnages. »
Pour lui, l’implacable, ce sont les questions. Viol, consentement, frontière entre bien et mal, zones grises morales : chaque roman est construit autour d’un nœud éthique. Les personnages naissent de ce nœud, sont pris dedans, s’y déchirent.
Là encore, tout repose sur la vraisemblance. Il revendique une quête obstinée du crédible : aucune scène, aucune réaction ne doit sembler artificielle. Rien n’est surréaliste, tout est potentiellement arrivé ou pourrait arriver.
Ce réalisme éthique est au cœur de son projet littéraire. Les histoires ne sont pas là pour nous flatter, mais pour nous confronter à ce que nous préférerions ne pas voir.

VI. Écrire sans pedigree, contre la tentation de l’IA lisse
Molmy a une vertu pédagogique rare : il ne fétichise ni la « vocation » ni la « grande culture » comme conditions d’accès à l’écriture.
« Le seul conseil que je donnerais, c’est : si vous avez envie d’écrire, essayez. La preuve, c’est que moi, je n’étais pas fait a priori pour ça. Et puis ça marche. »
Son apprentissage est simple : écouter les autres auteurs, écouter l’éditrice, se structurer peu à peu. Le style reste le même, mais la construction gagne en efficacité. La méthode, ici, n’est pas une théorie abstraite : c’est un ensemble de réflexes qu’on affine livre après livre.
Et face à l’intelligence artificielle, son intuition est tranchée :
« Je ne suis pas certain que l’intelligence artificielle menace vraiment. On voit, on sent les fragilités d’un texte, les erreurs, l’empirisme qui, a priori, ressemblent à des défauts, mais qui sont au fond la signature d’un texte. L’IA produit quelque chose d’extrêmement beau, lisse, mais qui n’a pas de relief. »
Écrire implacablement, ce n’est pas produire un texte parfait : c’est assumer le relief, les aspérités, les zones de risque. L’implacable, ici, c’est l’humanité faillible… et donc reconnaissable.
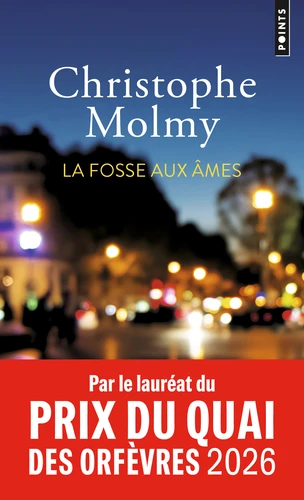
Conclusion : tenir le lecteur, se tenir soi-même
Christophe Molmy écrit comme il a commandé des opérations : avec préparation, sang-froid, attention aux détails, obsession du rythme et conscience aiguë de la complexité humaine.
Écrire implacablement, cela veut dire :
– préparer une Bible solide pour ne jamais perdre la cohérence
– construire des chapitres courts, centrés, accrocheurs
– utiliser le point de vue comme un scalpel moral
– couper sans pitié ce qui ne sert pas l’histoire
– choisir un sujet brûlant et s’y tenir jusqu’au bout
Le reste – la légitimité, la « formation », le pedigree littéraire – vient après. Ou pas du tout.
« Dès qu’on a besoin de sortir quelque chose et qu’on en a envie, il faut essayer. »
C’est sans doute la phrase la plus implacable – et la plus libératrice – de toute l’interview.
 Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :
Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :